que cultivaient-ils ?
 Le milieu du XIXe siècle fut le début d'une relative période de prospérité. C'est à cette époque que la population est au plus haut à Galan : 1456 habitants en 1852, elle tombera à 1241 en 1887. La polyculture est pratiquée à Galan grâce à la diversité des terroirs et à la qualité du climat, ce qui assure une relative sécurité.
Le milieu du XIXe siècle fut le début d'une relative période de prospérité. C'est à cette époque que la population est au plus haut à Galan : 1456 habitants en 1852, elle tombera à 1241 en 1887. La polyculture est pratiquée à Galan grâce à la diversité des terroirs et à la qualité du climat, ce qui assure une relative sécurité.
- - les céréales,
L'appellation "Bled" ne signifie pas "blé", mais "céréales", et plus précisément, les céréales - aux qualités inégales - avec lesquelles on peut faire du pain, ce sont selon le "Dictionnaire du Cultivateur" de 1769 évoqué plus bas :
- le Froment, c'est le blé, à l'époque, essentiellement du blé tendre, "à paille longue et souple, sujet à la verse. Le pain fait avec les variétés saragnet ou galer est très savoureux" [Marthe Délas. Op. Cit.]. Le blé dur à paille courte qui apparaît à partir de 1950 a certes un rendement supérieur, mais sa farine, disent les anciens, est banale.
- le Seigle, pas aussi prisé qu'en Bretagne, sert aussi de chaume pour recouvrir les toits.Athur Young* ne décolère pas contre les Français qui privilégient la culture du seigle : "La surabondance de seigle dans toutes les parties de la France, même dans les plus riches, est probablement l'une des plus grossières absurdités de l'agriculture européenne... Cependant, il n'est pas un sol, dans tout le royaume, qui soit assez mauvais pour exiger du seigle. Tout, dans l'ensemble, est assez bon pour le blé.
* Arthur Young, Voyages en France. Passionné d'agronomie, il découvre la France, dont notre région, au cours de trois voyages qu'il fait dans les années 1780.
- Le Bled méteil ou méteil, 2/3 de froment et 1/3 d'avoine est toujours cultivé. À noter aussi le carrou, mélange de blé et seigle.
- Le Bled de Turquie [maïs],
- l'Orge de printemps n'est pas très répandu ; il sera détrôné au XXe siècle par l'orge d'automne ou escourgeon,
- l'Avoine, les chevaux en raffollent, existe sous deux formes :
-d'automne au grain clair et paille longue,
-de printemps au grain noir et paille courte qui a un rendement meilleur.
- le Bled noir, ou Bled sarazin.
Sont dénommés "mars" les céréales qu'on sème dès le mois de mars, à savoir, l'Orge, l'Avoine, la Vesce, la Dragée - non référencée à Galan - qui est un mélange d'un tiers d'avoine avec des pois ou des vesces. À ce mélange, on peut rajouter des fèves, des lentilles ou du lupin.
À Galan, l'avoine représentait 15% des céréales, davantage que la moyenne du département qui est de 10%, rendement 25 hl/ha.
Le sarrasin qui donne une farine appréciée est absent, plutôt cultivé en montagne, en Barousse notamment.
Pas trace de petit millet qui est la spécialité de Pouzac où il entre dans la fabrication du pain.
Le maïs connaît son essor en France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle (voir ci-après). C'est un événement d'importance : le maïs amène la sécurité. Si les récoltes de blé et de seigle se révèlent médiocres, on peut espérer que le maïs, dont la culture est décalée dans le temps par rapport à celle du blé, permettra d'éviter la disette. On remarque de plus que les tiges de maïs pourront partiellement se substituer au foin, si celui-ci vient à manquer, pour nourrir les bestiaux en fin d'été et que les pieds de maïs enfouis dans le sol tiennent lieu d'amendement. Galan a la chance d'avoir un climat propice à la culture du maïs, le rendement est honnête : 18hl/ha.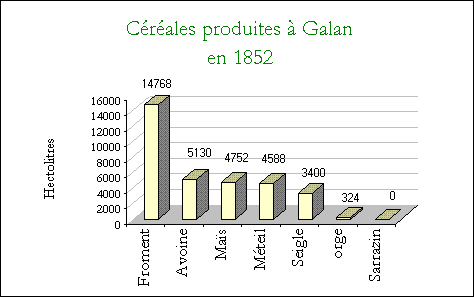
(Histogramme, comme les suivants, réalisé d'après les données de l'Indicateur des Htes-Pyrénées. Auteur : Joseph-Bertrand Abadie, de Sarrancolin. 1856) - Autres cultures :
- - les légumes divers : choux, pois, haricots verts, salades,
- - les "racines" : carottes, raves, navets, turneps (variété de navets fourragers d'origine anglaise), betterave rouge (une nouveauté) et blanche, rutabaga,
- - les légumes secs : haricots, pois, fèves,

- - le lin, culture courante dans la région, On se doit d'en avoir un peu pour les besoins de la maison et on pense déjà à robe de la petite qui se mariera. On ne parle pas du chanvre cultivé modestement dans d'autres cantons,
- - Le petit millet et le colza ne sont pratiquement pas cultivés à Galan. Par contre le millet est cultivé couramment. En 1887, l'instituteur de Galan signalera cette nouveauté qu'est la culture du colza,
- - Le tabac qui commence à être cultivé dans le département à la fin du XIXe siècle n'est pas signalé à Galan.
[Source : Gens et choses de Bigorre. Société Ramond et CNRS. 1967.]
C'est donc une nourriture fondamentale, presque quotidienne. Laboulinière, Secrétaire Général de la Préfecture des Hautes-Pyrénées, écrit dès 1825 que les diverses préparations du maïs - voir pour les recettes de pastet en particulier : La nourriture de tous les jours et Un repas Gascon de Joseph de Pesquidoux, la recette du milhas - , sont aussi économiques que nourrissantes. : galettes de milhas, pastet et pain appelé mestura. Cette notion était encore répandue il n'y a pas si longtemps : Madame Soulès de Bonrepos me l'a confirmé, tandis que son fils Claude ajoutait qu'il en était un peu saturé. Puis le maïs fut utilisé pour l'alimentation des animaux, volailles et porcs. L'été, une tradition encore vivante récemment voulait que, pour renforcer la plante, la fleur soit coupée et donnée à manger aux vaches. Mais le maïs n'a pas que des applications alimentaires. Ses sépales servent à remplir les paillasses, ses épis une fois dépouillés du grain ravivent le feu, et dans la mode féminine, on l'utilise pour fabriquer des bonnets "pour les jours de dimanche et fêtes" réputés élégants et imperméables.
Les incidences du maïs sur la vie paysanne furent donc considérables, on a donc parlé de révolution :
- l'ère des famines sévères disparaît et le quotidien alimentaire est amélioré,
- la plante étant exigeante en amendements, les façons culturales doivent s'adapter : la jachère improductive se trouve réduite, l'assolement qui était biennal, jachère une année sur deux, devient peu à peu triennal, jachère une année sur trois. L'intérêt suscité par la culture du maïs est tel qu'elle entraîne des défrichements importants souvent au détriment des forêts. Enfin les vaches y trouvent, avec les "jambes" de maïs, un supplément de nourriture non négligeable en automne quand l'herbe se raréfie.
Il faut noter que c'est le Sud-Ouest de la France qui bénéficia surtout du miracle, car il y règne un climat de prédilection pour le maïs. "Elle [la plante] a besoin de longs soleils et de pluie. Elle frémit à l'air flamboyant, elle ruisselle avec délices sous les orages d'été. À ce régime, dans les terrains d'alluvions, elle s'élève jusqu'à trois mètres " *.Il fallut attendre bien des décennies avant que le maïs, à l'aide d'hybrides convenables, parvienne à envahir l'Artois et le Douaisis.
Pour d'autres précisions sur l'avènement du maïs, voir Les Richesses de Galan, la vie végétale.
- La pomme de terre bien qu'introduite en France depuis longtemps, mais comme une curiosité péruvienne puis espagnole - vers 1600 Olivier de Serres la décrivait sous le nom de cartoufle - fait une apparition tardive et timide dans la région à la fin du XVIIIe siècle où elle est cultivée dès 1780, semble-t-il, à Sarrancolin provenant de l'Aragon et du Comminges. Mais le légume est au début déprécié, qualifié avec dérision de "pain des pauvres". On le trouve pénible à récolter, lourd à transporter, difficile à conserver, de plus il contient 75% d'eau... Les cochons l'aiment et faute de mieux on consomme la pomme de terre pendant la mauvaise saison bouillie avec du sel aux principaux repas. "Au dîner, on les broie et on les mêle avec des choux et des haricots auxquels on ajoute un peu de graisse" (Dralet, cité par "Bigorre et Quatre-Vallées", voir Références bibliographiques sommaires).
Une gravure de la Botanique de Regnault datant de 1774 la présente peu appétissante. Et cette mauvaise réputation persiste chez certains jusqu'au XIXe siècle : Pierre Larousse dans son grand Dictionnaire de 1875 va même jusqu'à prétendre, sans citer ses sources, que ce légume a la réputation de donner la lèpre à ceux qui en mangent.
Turgot, le Ministre de Louis XVI, n'est pas parvenu à faire adopter la pomme de terre. Mais Louis en personne est convaincu ; il met 50 arpents de l'infertile plaine des Sablons près de Paris à la disposition d'Antoine Parmentier, un pharmacien qui, ayant séjourné en Allemagne, connaît l'intérêt du tubercule. Lors de la première récolte Louis XVI arbore même la fleur à sa boutonnière. La sévère disette qui sévit en France en 1769 précipite les choses. L'Académie des Sciences propose comme sujet de prix d'indiquer les végétaux qui pourraient suppléer en temps de disette à ceux qu'on emploie communément à la nourriture des hommes; Parmentier l'emporte avec la pomme de terre. Et c'est le point de départ d'une campagne publicitaire rondement menée : la Faculté de Médecine est sollicitée pour déclarer que le légume n'est pas nuisible, Parmentier publie des analyses chimiques rassurantes. Pourtant Pierre Larousse dans son grand Dictionnaire de 1875 va même jusqu'à prétendre (sans citer ses sources) que ce légume avait la réputation de donner la lèpre à ceux qui en mangeaient.
Mais la cause de la pomme de terre est gagnée. Par snobisme on se délecte de la pomme de terre à la Cour et des gardes empêchent le vol à la plaine des Sablons. Parmentier est appelé "bienfaiteur de l'humanité".
Voici ce qu'écrit Chaptal au début des années 1800 dans l'"Industrie Française" au chapitre "Des progrès de l'agriculture" (Voir "La vie est elle plus facile du fait du développement de l'industrie au XIXe siècle ?" et Références bibliographiques sommaires) :
| ...On la cultive partout, parce qu'on en a connu tout le prix dans les années où le blé manquait aux besoins de la France... Cet aliment que rejetait le pauvre, est aujourd'hui admis sur la table du riche et on le regarde, avec raison, comme le plus puissant auxiliaire du froment. Comme aliment, la pomme de terre n'exige presque aucune préparation, et néanmoins elle se prête à tous les goûts, et supporte tous les apprêts, sans perdre toutefois la qualité qui la caractérise. Comme nourriture des bestiaux, la pomme de terre est encore une des meilleures et des plus économiques qu'on puisse leur donner pendant l'hiver. Sous tous rapports, la pomme de terre est une des conquêtes les plus précieuses qu'ai faites l'agriculture depuis bien des siècles... Petit détour linguistique. Le mot "pomme de terre" a, en patois bigourdan, des traductions diverses selon les villages : mandorras à Tournay et Galan, trufés à Barèges, toumatas à Arrens. C'est la caractéristique du patois, il faut donc plutôt parler des patois : certains mots sont propres à un village. Problème évoqué au début du chapitre "Morceaux choisis". |
- Dans le jardin, traduisez "le potager", entretenu par "la femme" poussent les légumes traditionnels dont le poireau, appelé alors "porreau"; (Voir plus loin la liste des légumes usuels à cette époque). Les arbres fruitiers y sont acceptés : abricotiers, pêchers de vigne, poiriers, pommiers, pruniers; et souvent dans l'allée centrale une tonnelle de raisins de table : chasselas ou muscat de Hambourg.
- Les fruits sont appréciés, bien que le verger ne soit pas courant.
Les pommes alors sont la calville et les reinettes qu'on sait conserver pour l'hiver en les enfouissant sous un tas de blé ou de regain. La golden et la grany smith ne sont pas mentionnées... Les poiriers à la belle silhouette quand ils deviennent adultes sont plus rares mais on peut en manger dès la Saint Jean.
Les pêchers, les figuiers, les pruniers et les cerisiers sont partout. Une variété de cerises particulièrement appréciée et qui semble ne plus exister était la grosse cerise noire qu'on appelait "merise". Un délice ! Quant aux prunes, on en réservait une partie pour faire de la fine et les inconditionnels en mangeaient à toute heure et sans réserve, même si c'était de la "prune à cochon" le fruit grenat du prunus.
Une mention spéciale pour la griotte qui existe à l'état sauvage dans les bois de Recurt et pour la prunelle que "la femme" va cueillir dans les haies pour faire une bonne liqueur.
- Les prairies sont abondantes, le climat étant favorable,.

surtout naturelles et pour une part non négligeable, artificielles : 12%, la moyenne pour le département étant seulement de 6%. Des pâturages communaux étaient à la disposition des plus démunis.
- Les châtaignes avec leur bogue sont ramassées et stockées en prévision de l'hiver. Après Tournay, Galan était le 2ème producteur de châtaignes du département : plus de 42 tonnes par an. Le bois est précieux, il a entre autres, l'avantage de ne pas être attaqué par les vrillettes ; on l'utilise pour faire des planchers, des escaliers, des poutres, des douves de tonneau.
- La vigne. Chacun est fier de sa vigne. Elle nécessite une vaisselle vinaire importante et de nombreuses façons culturales, mais qu'importe, la tradition veut que chaque propriétaire en "soigne" une pour sa consommation personnelle bien que le degré alcoolique soit faible, 7° au plus, et les récoltes précaires, Galan se situant à quelque 300 mètres d'altitude, limite supérieure admise pour une zone vinicole. Là, on peut noter une petite exagération d'Abadie de Sarrancolin, car il écrit :"...Les vins rouges que l'on récolte dans le nord du département sont très estimés; ils ont beaucoup plus d'alcool que les vins de Bordeaux lorsqu'ils ont acquis la force que leur donne l'âge".
Curieusement, dans maintes villes du département, la production en vin blanc est relativement importante : à Galan, 47% du total.
L'oïdium apparut vers 1851 et fit baisser brutalement les récoltes de 40%; les prix montèrent sensiblement : 55 centimes le litre de vin rouge en 1856, alors qu'il valait 10 centimes en 1838. Le remède prôné officiellement, coûteux et sans grand effet, était le drainage. Le traitement au soufre, alors ignoré, fut découvert à point nommé par le chimiste Henri Marrès en 1855. Dès lors la maladie disparut aussi vite qu'elle était survenue. Le vin blanc était souvent à base de cépage "noah", ce raisin maudit qui, à tort ou à raison, fut accusé après la dernière guerre d'engendrer des maladies mentales, ce qui, dit-on, entraîna le développement de l' Hôpital Psychiatrique de la Demi-Lune à Lannemezan et, ce qui crève encore le cœur des paysans locaux, l'obligation d'arracher ces ceps. Tout le monde ici aimait bien le noah au goût original et délicieux; il avait aussi la propriété de faciliter la conservation des vins de faible degré qui l'avaient accueilli dans leur assemblage. De plus, il fut un des seuls cépages à pouvoir résister au phylloxéra survenu en France dès 1863, et représentait à Galan dans le troisième tiers du XIXe siècle 47% de la production (71% à Trie-sur-Baïse).
Chaque année, le "bourret", le nouveau millésime encore légèrement pétillant, est dégusté accompagné de commentaires sur la qualité du cru de l'année avec des châtaignes grillées, et la tradition subsiste, on attend, impatient et un peu inquiet, le jugement bienveillant des voisins ou amis. C'est important, on s'est donné du mal ! A noter : le cidre n'est pas en faveur, la qualité n'est pas à la hauteur.
Les conséquences inattendues de ces progrès :
Curieusement, si ces nouvelles ressources alimentaires que sont le maïs et la pomme de terre permettent d'éviter la disette, ce qui est un progrès certain, la situation n'est pourtant pas aisée en matière d'alimentation. En effet, un phénomène nouveau apparaît, c'est le surpeuplement qui engendre, d'une part une augmentation du prix des terrains arables et un défrichement excessifs de terres quelquefois médiocres, et d'autre part une tendance des jeunes à émigrer. La mécanisation, qui pourtant tarde à s'imposer, engendre des effets inattendus : les familles nombreuses à l'époque étaient quelquefois trop nombreuses pour l'importance de la propriété et la main d'œuvre excédentaire soit se louer comme elle peut, ambitionne soit d'aller à la ville pour y trouver quelque emploi - de fonctionnaire de préférence -, soit de s'expatrier au Mexique, aux États-Unis surtout, ou en Amérique du sud, entre autres. Chaque famille ici peut en citer des exemples. Les Barbat très nombreux à Galan durant la 2ème moitié du XIXe siècle virent un enfant partir à 19 ans pour la Floride. Un de mes ancêtres, Ibos de Galez, alla travailler à la Nouvelle-Orléans où il se fit appeler "Ybos" et bien d'autres encore dont les descendants américains recherchent avec amour les traces par l'intermédiaire de Cercles Généalogiques.
Heureusement, cette relative prospérité a, techniquement, des effets bénéfiques : en effet, on va s'efforcer d'augmenter les rendements et de mécaniser les tâches. C'est la naissance de la génétique appliquée. On améliorera les races ovines et bovines par des croisements avec des étalons étrangers. Des blés et des seigles importés d'Allemagne, du Danemark, d'Écosse apparaissent sur le marché dès 1880 importés par la célèbre famille de Vilmorin dont le livre Les meilleurs blés fait alors autorité. Notre région s'y intéresse tardivement, au début du XXe siècle seulement.
Les légumes cultivés au "jardin" à la fin du XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle. |
"Le Spectacle de la nature, ou Entretiens sur les particularités de l'histoire naturelle"
Les goûts d'autrefois pour les différents légumes.
Les sujets traités sont :.
| – les façons culturales, | ||||
| – la "bonté" (les qualités gustatives), | ||||
| – la "diète" (la plante est un médicament). | ||||
On distingue 7 classes de Légumes :
- Les racines,
- Le salsifis est de deux sortes : le commun et celui d'Espagne ou scorsonère. Ce dernier est semé au printemps et au mois d'août, il doit demeurer deux ans en terre. Le commun se sème au printemps et se récolte au plus tard au Carême de l'année suivante.
- Le chervi se sème et se plante fort dru... [D'après l'Encyclopédie de Diderot et d"Alembert de 1778, le Chervi est une plante à fleurs dont les racines sont attachées à une sorte de tête comme les navets. Cette racine est très douce et par conséquent très "alimenteuse". On en fait un usage fort commun à titre d'aliment ; on la sert sur les meilleures tables, apprêté de diverses façons. Cette racine passe à juste titre pour fort saine. Boerhaave la recommande dans les crachements & les pissements de sang, & dans les maladies de poitrine qui menacent de la phtisie, dans la strangurie, le ténesme, la dysenterie & la diarrhée : il conseille ses racines dans ces cas, cuites dans le lait, dans le petit-lait, dans les bouillons de viande, & il les fait entrer dans tous les aliments de ces malades. Les racines de chervi ont passé encore pour apéritives, diurétiques, vulnéraires, excitant la semence, donnant de l'appétit, etc., mais en général on ne se sert presque pas de ces racines comme médicament].
- Les panais & les carottes blanches, jaunes, rouges et violettes se sèment en avril et on les "lève" avant l'hiver
- Les navets. On les sème au printemps pour en avoir l'été
- Les raves. Semis dès le mois de décembre, récolte après 5 ou 6 semaines en terre.
- La bete-rave est semée et transplantée au printemps, on la lève avant les gelées
- Les topinambours ou poires de terre sont des excrescences ou des tubercules qu'on détache des racines d'une plante fort hautes qui proviennent de la partie du Brésil où demeurent les peuples nommés "Topinambours". D'autres disent qu'elle vient du Canada... Ces poires sont bonnes cuites, & tiennent le goût de l'artichaut.
- Les truffes rouges ou pommes de terre. C'est une masse charnue qui végète sous terre dans les endroits crevassés et sablonneux... Elle se nourrit apparemment par ses spores. [On ressent un certain embarras dans cette description succincte ! La plante vient juste de faire son apparition et n'est pas encore en odeur de sainteté].
- La Verdure
- L'Oseille, tant la pointue que la ronde, peut se multiplier de touffes éclatées, ou se semer de mars à septembre.
- L'Arroche ou Bonne-Dame se sème dès le printemps, puis tous les mois ; elle sert à dorer [?] les potages et à faire certaines farces fort estimées
- La Poirée ou Bette-blanche se sème en mars. On la coupe pour l'usage journalier et elle repousse comme l'oseille
- La Bourrache et la Buglose (maintenant, appelée buglosse) servent à faire des bouillons amers mais salutaires, & souvent préférables aux remèdes étrangers.
- L'alleluya est plus rafraîchissant : c'est une espèce de trèfle qui se multiplie de brins entrelacés. L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert après avoir décrit l'alleluia en détail - elle le nomme oxytriphillon - lui confère les indications thérapeutiques suivantes : "Il est bon pour désaltérer, pour calmer les ardeurs de la fièvre, pour rafraîchir, pour purifier les humeurs. Il fortifie le cœur, résiste aux venins. On s'en sert en décoction, ou bien on en fait boire le suc dépuré".
- Le persil, tant le commun que le frisé, & le persil de Macédoine qui est plus aromatique que les deux autres, nous servent par leurs feuilles et par leurs racines. On peut faire blanchir le persil de Macédoine pour en faire des salades d'hyver, comme on en fait avec le céleri qui paraît être une quatrième espèce de persil. [Effectivement, ces deux plantes sont de la même famille, les Apiacées].
- Les épinards. On les sème en août et septembre. Ils prolifèrent tout l'hiver et sont la manne du Carême.

Le Chou "Daubenton" - Les choux. On les sème dès le printemps et plusieurs mois de suite... On arrache plusieurs choux d'hyver avant les gelées, & on les conserve attachés la racine en haut, ou plutôt la racine enfoncée dans le sable.
- Les choux-fleurs, dont la bonne graine vient de Chypre & de Malte se sèment et se conservent comme les choux ordinaires.
- Les brocolis, petites branches qui renaissent sur les tiges des choux qu'on a coupés, sont de rigueur dans bien des ragoûts sur les meilleures tables. C'est une variante du chou brocoli Italien si apprécié.
- Les salades, qui font toujours partie de la bonne chère.
- Les laitues seules se relayent durant six mois, pour nous rafraîchir tour à tour. Les laitues à coquille, & celles de la passion résistent à la gelée, surtout si on a pris soin en automne de les placer sous un bon aspect ou sur un ados : elles commencent à pommer dès le mois de mars. La petite crêpe et la grosse ne tardent pas à pommer sur couche et sous cloche : elle peuvent même être de service avant les précédentes. La laitue royale, la Saint-Germain, la Grosse-Blonde, la Blonde de Mèts & surtout la laitue-George, replantées en pleine terre, pomment à souhait jusqu'aux grandes chaleurs. On sème pour l'été les laitues de Boulogne et de Gênes, blondes, rousses, vertes, rouges, & toutes celles qui ne montent pas. On les lie quelquefois pour les faire mieux pommer. Les laitues de Perpignan et de la passion réussissent encore en automne. Les laitues Romaines qu'on a de même semées et liées à propos en été peuvent prendre la place des laitues, quand la chaleur fait monter celles-ci trop vite. La laitue Batavia, qui commence à devenir commune, l'emporte sur toutes les autres par sa douceur & par la facilité d'en avoir pendant tout l'été.
- La chicorée. On la sème de mars à juillet. On les replante au large en différents tems puis on les lie pour les faire blanchir... Nous avons maintenant une chicorée très douce qui se coupe comme l'oseille six semaines de suite & plus en été sans monter en graine, & qui remplacent les laitues quand elles manquent.
- Le céleri se sème dès le printemps... On le butte en amoncelant la terre à ses côtés jusqu'au haut des feuilles qu'on ébarbe. Il blanchit au bout d'un mois. On le conserve en terre où il continue à blanchir si la lumière n'intervient pas.
- La chicorée sauvage, dont les racines et le feuillage sont appréciées, est semée de quinze jours en quinze jours à partir de la fin de février. Ainsi, une telle salade, tendre, est disponible à coup sûr pour les inconditionnels.
- Les fournitures sont des herbes qu'on mélange modérément aux salades.
- La pimprenelle et le cerfeuil sont de tous les tems.
- Le pourpier vert et le pourpier doré, selon les saisons,
- Le cresson alénois qu'on sème tous les huit jours pendant l'été et le cresson d'eau qu'on ne recueille pas dans les potagers, mais au bord des ruisseaux et des fontaines si posible au plus près de la source pour éviter une contagion toujours possible de la douve

La Raiponce - Les mâches et les raiponces, variété de campanule de la famille des valérianacés, qu'on peut semer dans le potager, ou cueillir dans les terres à blé où elles se sèment tous les ans d'elles-mêmes.
- Il faut être encore plus retenu dans l'usage des herbes fines et odoriférantes. telles que sont :
- L'estragon.
- Le baume ordinaire et le baume citronné.
- La civette d'Angleterre ou apétit.
- Le coq, l'anis, le fenouil, la petite mélisse ou citronnelle, le basilic, & la roquette.
- Les légumes proprement dits,
- L'oignon et les plantes bulbeuses. La pluspart des légumes étant assez insipides, on les relève par le secours des plantes fortes, qui par leur sel volatil et piquant en font comme l'assaisonnement naturel. Elles tiennent toutes de la nature de l'oignon qui est la plus éstimée d'entre elles. Les autres sont le poireau, la ciboulette, l'echalotte et la rocambole.
L'ail a de quoi contenter le palais le plus difficile à émouvoir. La campagne en fait grand usage, & on pourrait l'appeler la theriatrie des païsans. - Le poireau. Il se sème au printemps et on les transpalante afin qu'ils grossissent étant mis plus au large.
- Les vrais légumes sont les fèves, les pois, les haricots dont les espèces varient beaucoup, réussissent mieux dans la terre légère & sablonneuse que dans la forte. La pluspart demandent le secours des rames et beaucoup d'air entre deux routes [sic], pour pouvoir donner abondament. On a soin de pincer ou de ronger les fèves pour fortifier la tige et les cosses en retranchant par le montant. On ôte par le même moyen une légion de pucerons qui s'attachent vers le haut où le verd est plus tendre.
- L'oignon et les plantes bulbeuses. La pluspart des légumes étant assez insipides, on les relève par le secours des plantes fortes, qui par leur sel volatil et piquant en font comme l'assaisonnement naturel. Elles tiennent toutes de la nature de l'oignon qui est la plus éstimée d'entre elles. Les autres sont le poireau, la ciboulette, l'echalotte et la rocambole.
- Les fruits potagers, ou fruits de la terre. Le potager, après toute cette multitude de racines, d'herbes, & de légumes qu'il nous prodigue, met le comble à ses libéralités par les fruits de la terre plus estimables encore que tout ce qui a précédé. Les fruits de la terre qui viennent à plate terre sont les suivants :
- Les asperges, dont la première culture est un peu longue. Mais s'il en coûte de la patience et des soins, un plan d'asperges vous récompense vingt &t vingt-cinq ans de suite, quelque fois plus. [L'auteur expose par le menu l'art de cultiver l'asperge].
- Les artichauts et les cardes. Pour les artichauts, leur culture est plus aisée. Tout s'y réduit à les loger dans un excellent fonds qu'on engraisse le plus qu'il est possible ; à planter en échiquier les œilletons qu'on a détaché des plus forts piés avec un peu de racines ; à les espacer de trois piés ou plus si la terre est forte, afin qu'ils aient plus de place pour étendre en liberté leur large feuillage ; enfin à les garantir de la gelée, en les butant,c'est à dire en amassant la terre autour de leurs feuilles racourcies, ou en couvrant le tout de long fumier sec... On les lie, & on les empaille sans leur donner aucun air par le haut. Ils blanchissent comme des cardons d'Espagne, dont le gouvernement est à peu près le même.
- Les concombres, les potirons, les courges. Ne les méprisons pas. On en fait des potages, des ragoûts, du pain, & des remèdes. La culture en est entièrement semblable à celle du melon, si ce n'est qu'on ne les taille pas avec autant de précision.
- Le melon est une des plus parfaites production du potager, & l'un des plus délicieux rafraîchissements que la nature, toujours attentive à nos besoins, nous ait préparés durant les grandes chaleurs. [La culture sur couches est décrite en détail].
1/ Plantes destinées à former les bordures des quarrés du potager : le thim, l'hisope, la sauge, la lavande, la marjolaine, l'absinte, la camomille, la rue, les violettes, & la sariette.
2/ Salades d'herbes confites. Pour ne pas être exposé à la rigueur de certains hyvers, ou même pour ménager d'agréables changements, on prépare de bonne heure de quoi joindre des salades cuites ou confites aux salades d'herbes crues. On les compose d'oignons de Catalogne, ou d'autres oignons blancs, de bete-raves cuites, de céleri cuit, de pointes d'asperges cuites, de plusieurs fruits ou herbes confites au vinaigre, comme sont les cornichons ou petits concombres, la perce-pierre, les capucines, qui sont des fleurs non épanouies, du cresson du Pérou, aujourd'hui fort commun, la criste marine, qu'on tire du voisinnage de la mer, enfin les câpres qui sont les boutons du caprier, & qui laissées quelque peu lohgtemps sur l'arbre, seraient devenu fleurs, & enfin fruits. Le caprier se plaît dans les décombres et dans les crevasses des murailles.
- Le sénevé à feuille de rave ou à feuille d'ache est la base de la moutarde, voir ci-après ses propriétés curatives. Le Sénevé de Sibérie a des feuilles comestibles qui se mangent en salade, mais c'est peu répandu.
 |
| Le raifort |
- Le raifort est une racine contenant de la sinigroside, le composant piquant de la moutarde, qui a des amateurs.
- La mélisse, "appelée aussi citronelle est peu employée dans l'alimentation quoique certains l'l'utilise comme fourniture pour assaisonner la salade, ou l'omelette, "comme on y met le persil", mais cela n'est pas commun. Elle sert à faire l'Eau de Mélisse, appelée aussi Eau des Carmes qui a de nombreuses vertus. La mélisse est : hystérique, céphalique et stomachique ; l'infusion en manière de thé, de feuilles sêches ou même fraîches est souveraine pour toutes les maladies du cerveau et pour celles des femmes, pour les palpitations du cœur, pour les défaillances, pour le vertige, pour la paralysie même & pour le mal caduc. On peut en mettre à bouillir légérement une poignée dans un bouillon de veau. L'eau est souveraine pour l'apoplexie, la léthargie, pour les vapeurs, les coliques, la suppression des règles & celle des urines".
La recette de l'"Eau des Carmes" n'est pas simple :
" - prenez 6 poignées de feuilles fraîches de Mélisse,
- une once d'écorce de Citron séchée,
- autant de Muscade et de Coriandre,
- une demi-once de Girofle et de Canelle,
concassez bien ces deux drogues, pilez les feuilles, & mettez le tout dans un vaisseau propre à les distiller avec deux livres de vin blanc et une demi-livre d'eau-de-vie ;laissez ce mémange trois jours en digestion, après avoir couvert le vaisseau de son chapiteau, auquel vous joindrez le récipient, dont vous boucherez exactement les ouvertures, & faites distiller ensuite cette matière au feu de sable modéré, ou au bain-marie".
 |
| La Patience |
Le Perce-Pierre évoqué plus haut a aussi pour noms : Bacille, Criste marine, Fenouil marin,Herbe de Saint-Pierre,
Le Poivre long, également nommé Poivre d'Inde, & Poivre de Guinée. "On en fait peu d'usage en France pour la vie et on le cultive plutôt pour la décoration des jardins et le plaisir des yeux que pour l'utilité ; cependant il sert à plusieurs choses : on le confit au sucre quand il est vert, et on le mange à la dose d'une demi-once pour fortifier l'estomac & dissiper les vents. Les vinaigriers s'en servent pour donner plus de force au vinaigre : il se mêle avec les Cornichons confits. Quelques personnes l'employent dans leurs aliments en place du Poivre ordinaire, et le trouvent de meilleur goût : mais dans les pays étrangers, tant aux Indes qu'en Espagne, en Italie & en Flandre même, il s'en fait une grande consommation ; les uns le mangent confit au sel & au vinaigre ; d'autres, qui s'y sont accoutumés de jeunesse, le mangent tout cru quand il est vert : j'avoue que cela peut paraître surprenant à ceux qui connaissent son goût âcre & piquant ; mais le fait n'en est pas moins certain, & j'en ai été témoin mille fois".
L'Épicerie, appelée maintenant nigelle, est une plante peu connue des jardiniers. "Elle peut servir de condiment en place des quatre épices ; il est vrai qu'elle a tout à la fois le goût de la muscade, du girofle, de la canelle et du poivre... Cette semence est utile en médecine, parce qu'elle est incisive, apéritive, vulnéraire & résolutive*. Étant mâchée, elle excite la salivation, & prise en décoction ou mêlée dans les alimens, elle augmente le lait des nourrices, elle provoque les mois aux femmes, résiste au venin & combat la fièvre quarte. Elle est bonne encore pour tuer les vers & chasser les vents."
*Résolutif, d'après l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, "se dit d'un médicament qui a la vertu de dissiper les humeurs qui embarrassent les parties & les distendent contre l'ordre naturel".
On trouve des renseignements voisins dans "Le Jardinier Solitaire" de MDCCLIX. Les deux ouvrages citent les différentes espèces d'arbres fruitiers qu'on plante dans les potagers :
- 48 variétés de poires dont la maturité s'echelonne de juillet à mars.
- 23 varités de pêches ; les avant-pêches sont mures à la mi-juillet, exemple : l'avant-pêche blanche dont "il n'y a point de curieux qui n'en ait un ou deux dans son Jardin". Les tardives, dont la Pavie rouge de Pomponne ou le Brugnon violet, se mangent à la fin septembre. - 16 variétés de prunes, de la Damas de Tours début juillet à l'Impératrice mûre en octobre.
- Les poires de juillet et août, Petit muscat ou Cuisse-Madame, de septembre, Bon-Chrétien, d'octobre, les Bergamottes, de novembre, la Marquise, d'hyver, la Colmart. Au total 48 variétés conseillées.
- Les pommes. 10 variétés des Reinettes aux Calvilles et à la Pomme d'Apy.
- moins nombreuses sont les variétés d'abricotiers et de cerisiers.
La médecine par les plantes :
Le potager se doit de produire des plantes ayant des vertus curatives. Ainsi, on apprend que :
- la décoction d'oseille dans du vinaigre est excellente contre la morsure des chiens enragés ; il faut en boire tous les jours plusieurs fois, & en laver la plaie qu'on enveloppe avec la feuille jusqu'à ce qu'elle soit guérie ; la même décoction fait passer la jaunisse, à raison d'une pinte par jour.
- Si on fait mâcher un dragme de graine de moutarde enfermée dans un linge, après l'avoir concassée légèrement, aux malades menacés d'apoplexie ou de paralysie, ce remède les fait cracher abondamment, il soulage aussi ceux qui ont la tête pesante et chargée de pituite. Cette graine est utile dans les affections soporeuses et léthargiques, elle est bonne aussi aux personnes sujettes aux vapeurs hystériques & hypocondriaques, dans les pâles couleurs, au scorbut, & dans les indigestions on l'emploie avec succès. Ainsi cette plante est apéritive, stomachale, antiscorbutique & hystérique.
...
QUIZ.
"Quel est nom actuel du légume appelé autrefois mélogène, ou mellogène?"Pour vérifier votre réponse, cliquez ICI. |
 Retour au menu "Les Paysans à Galan dans le courant du XIXe siècle",
Retour au menu "Les Paysans à Galan dans le courant du XIXe siècle",- ou retour au menu "Les Galanais autrefois. Portraits.",
- ou retour au menu "Histoire et histoires de Galan."
- ou cliquez ICI pour revenir au menu général.
